Journées d’étude des 1er et 2 juin 2016 "Les blessures psychiques de guerre dans l’histoire, de l’Antiquité à nos jours"
Mercredi 01 juin 2016 - Jeudi 02 juin 2016
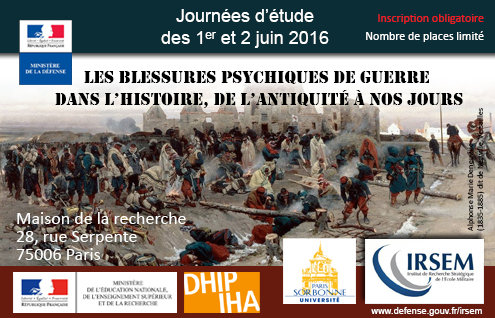
Journées d’étude des 1er et 2 juin 2016 de 9h00 à 17h00
organisées par l’université de Paris-Sorbonne (Centre de recherche MARS),
l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire et l’Institut historique allemand
Maison de la recherche, 28, rue Serpente, 75006 Paris, Salle D035
Nombre de places limité
Sous le haut-patronage de Jean-Marc TODESCHINI,
Secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense,
chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire
Présentation
Depuis un siècle, l’histoire de la guerre se caractérise par l’ampleur des pertes neuropsychiques au combat. Elle coïncide avec l’histoire de l’invention de la notion de traumatisme psychique (dernier tiers du XIXe siècle) et de la redécouverte des troubles post-traumatiques (fin du XXe siècle). Ces deux histoires ont interagi. La première – savante – a construit le traumatisme au gré des débats théoriques et des usages pratiques au sein des domaines de la médecine, de la psychiatrie, de la psychologie et de la psychanalyse. La seconde – morale – s’est inscrite dans la façon dont les sociétés ont transformé leur regard à l’égard des « traumatisés ». En ce début de XXIe siècle, les notions de « traumatisme psychique », de « syndrome post-traumatique », de « résilience », de « blessures psychiques » sont communément admises. L’histoire du siècle passé incite certains à conclure que les blessures psychiques sont une spécificité des guerres modernes de l’ère industrielle où les soldats sont fragilisés par la violence des combats, leur intensité et leur durée jusqu’à atteindre leur point de rupture. Les soldats d’antan, plus frustes, plus rudes, engagés dans des batailles de plus courte durée, auraient été plus endurants au feu, stoïques et d’un courage granitique. Or l’homme, physiologiquement et psychiquement, est le même depuis des millénaires. Les traumatismes psychiques sont aussi vieux que la guerre. La peur, le stress et la folie ont toujours hanté les hommes sur les champs de bataille.
Depuis plusieurs années, historiens, psychiatres, psychologues et psychanalystes réinterrogent les récits des batailles de jadis, les mythes, la littérature offrant une nouvelle grille de lecture pour identifier rétrospectivement des situations comparables à la période actuelle, ce qui revient à reconnaître des mécanismes inconnus ou incompris par les contemporains des faits sans commettre pour autant d’anachronisme. Les récits de bataille sont en effet émaillés d’anecdotes montrant des soldats des armées de terre et de mer touchés par des symptômes psychiatriques, qui sont regroupés actuellement sous les termes génériques de « réactions de combat » ou « réaction de conversion » (cécité, paralysie, surdi-mutité, etc.). Les symptômes d’effondrement psychique, de fatigue de combat, de peur se manifestent de bien d’autres façons que les historiens décèlent dans les guerres, quelle que soit l’époque, et que la psychiatrie militaire définit comme des « réactions secondaires » (blessures volontaires, paniques, désertions, mutineries, suicides, Berserk, assassinats d’officiers jugés incompétents, pieds gelés, maladies vénériennes, etc.).
Ces journées d’étude ont pour ambition de rappeler que les blessures psychiques de guerre n’ont pas commencé avec la Première Guerre mondiale, pas plus que leur prise en compte. C’est depuis l’Antiquité que de tels phénomènes doivent être examinés. Pour la première fois, historiens, médecins et militares se retrouvent pour livrer au public les résultats de leurs travaux interdisciplinaires, effectués au sein des quinze ateliers de recherche organisés à l’IRSEM, sur les mots, les sources, les approches et surtout ces troubles qui réduisent l’efficacité opérationnelle quand ils ne marquent pas à vie.
PROGRAMME DU MERCREDI 1er JUIN 2016
····································· Terminologie et expression ······································
09h15 Introduction aux journées d’étude : Définitions du sujet, approches, problématiques
- Olivier CHALINE, professeur, université Paris-Sorbonne
- Michèle BATTESTI, directrice du domaine « Défense et Société », IRSEM
09h30 TABLE RONDE : Terminologie et expression des troubles psychiques
Avec la participation de
- Frédéric CANINI, médecin en chef, professeur agrégé du Val-de-Grâce, Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA),
- Marion TROUSSELARD, médecin en chef, professeur agrégée du Val-de-Grâce, IRBA,
- Olivier CHALINE et Michèle BATTESTI
11h00 Questions
11h15 Pause
························· Sources, représentations et interprétations ···························
11h30 Représentation des troubles psychiques chez Plutarque
- Jean-Marie KOWALSKI, responsable du département sciences humaines, École navale
***
14h00 À la lecture de l’Éneide
- Antoine SCHÜLÉ, historien de la sécurité et de la défense (Suisse)
14h30 De l’existence d’un traumatisme de la conquête chez les Mongols du XIIIe siècle ?
- Laurent QUISEFIT, chargé de cours à l'Institut national des langues et civilisations orientales, chercheur associé à l'UMR8173 Chine, Corée, Japon (EHESS/CNRS)
15h00 Japon : appréhension, témoignage et héritage du combat
- Yves CADOT-DAUNIZEAU, maître de conférences, université de Toulouse Jean Jaurès
15h30 Questions
15h45 Pause
16h00 « Récits » militaires (du XVIe au XIXe siècle)
- Michèle BATTESTI, directrice du domaine « Défense et Société », IRSEM
16h30 Blessures psychiques des combattants de l’Empire. Sources d’étude et premières approches
- François HOUDECEK, historien, Fondation Napoléon
17h00 Traumatisation by physical and mental violence in national socialism. The debate on damage and compensation since the 1950s
- Wolfgang ECKART, professeur d’histoire de la médecine et directeur de l’Institut d’histoire de la médecine à l’université de Heidelberg
PROGRAMME DU JEUDI 2 JUIN 2016
····································· Approches et études de cas ······································
09h00 Étude de cas : Sparte
- Jean-Christophe COUVENHES, maître de conférences, université Paris-Sorbonne
09h30 Préparation à la guerre et retour à la paix de la République au Principat
- Yann LE BOHEC, professeur émérite, université Paris-Sorbonne
10h00 Les traumatismes de l’armée française pendant les guerres d’Italie (XVIe siècle)
- Laurent VISSIÈRE, maître de conférences, université Paris-Sorbonne
10h30 Questions
10h45 Pause
11h00 Le phénomène des paniques dans l’armée française pendant la guerre de Succession d'Espagne
- Clément OURY, docteur en histoire, président du groupe de révision de PRESSoo à l’International Standard Serial Number (ISSN)
11h30 Frédéric II, roi de Prusse, face à l’imminente défaite, 1759
- Olivier CHALINE, professeur, université Paris-Sorbonne
12h00 Questions
***
14h00 Le choc psychologique de la conquête dans l’espace amérindien
- Daniel LÉVINE, professeur, université Paris-Sorbonne
14h30 Les traumatismes des soldats de la Première Guerre mondiale : le traitement par la psychanalyse
- Gilles TRÉHEL, docteur en psychologie, Centre d'études psychopathologie et psychanalyse, université Paris VII-Jussieu
15h00 Questions
15h15 Pause
15h30 Actualité du psychotraumatisme de guerre : les expériences des opérations PAMIR et SANGARIS
- Emmanuel FRÈRE, chef de bataillon, psychologue, Cellule d’intervention et de soutien psychologique de l’armée de terre (CISPAT)
16h00 En revenir ? Penser les facteurs pathogènes et les facteurs protecteurs à partir d’expériences opérationnelles
- Hervé PIERRE, colonel, cabinet du chef d’état-major de l’armée de terre
16h30 Questions
16h45 Conclusions
- Jacques FRÉMEAUX, professeur agrégé de l’université Paris-Sorbonne,
- Franck DE MONTLEAU, médecin chef des services, professeur agrégé du Val-de-Grâce, HIA Percy, Service de psychiatrie
<< Télécharger le programme >>


